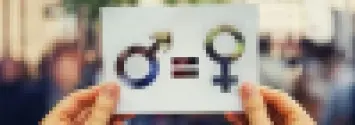La lutte pour l’environnement est l’ensemble des agissements citoyens, politiques et sociétaires qui œuvrent dans un combat planétaire de niveau international dans un but précis : préserver l’environnement. La protection de l’environnement regroupe l’ensemble des mesures locales pour mener à bien des actions de sensibilisation, des décisions inter-étatiques pour minimiser, réduire les risques et protéger l’environnement. La protection de la nature se résume à une lutte à long terme, précise, réfléchie et qui suit une logique d’interaction planétaire. Aujourd’hui, la lutte suit une dynamique, une pensée, un contexte et un volontariat. L’écologie est une discipline scientifique qui étudie le comportement des êtres vivants dans leur milieu naturel. Les impacts climatiques tels que l’effet de serre ou la déforestation, entraînent mécaniquement une disparition des espèces endémiques, la déstabilisation de la pollinisation chez les plantes, et même jusqu’au comportement des abeilles, de la disponibilité des plantes médicinales et l’apparition de nouvelles maladies chez l’homme. Pour faire face à cette menace, des idéologies sont apparues aux quatre coins du monde, des scientifiques ont tirés les sirènes d’alarme, des écologistes ont haussés leur voix, des dirigeants ont pris la parole pour créer un monde meilleur. Dans ce contexte, le développement durable est une logique largement acceptée, qui se définit comme un développement “répondant aux besoins du présent sans compromettre l’avenir de la génération future”. Ainsi, tous les documents de base de la politique économique des pays membre des Nations Unies, doivent suivre le protocole de développement durable, pour que toutes les actions en faveur de l’environnement convergent dans le même objectif.
Impact sur l’environnement : de nombreuses activités humaines
La surproduction, la révolution du transport et les progrès technologiques ont accéléré la dégradation de l’environnement. C’est à partir du changement climatique, des catastrophes naturelles et des maladies des grandes villes que les scientifiques ont tirés la sonnette d’alarme pour minimiser les risques.
Une conséquence de la surconsommation
Bien que la phase de transition énergétique ait été enclenchée, la planète continue à se reposer sur les énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) pour se déplacer, se chauffer et produire de l’électricité. Et aujourd’hui, notre planète souffre de la consommation toujours très forte et demandeur. La surconsommation d’hydrocarbures entraîne une pollution industrielle dans les grandes villes, les rejets de gaz dans l’atmosphère des usines industrielles contribuant eux aussi au réchauffement de la planète. Ces rejets entraînent une accumulation des gaz à effet de serre, qui modifient la qualité de l’air, de l’eau et de l’oxygène. Cette situation a des effets néfastes sur la croissance des êtres vivants, notamment sur la faune et la flore. À cela s’ajoute la surpopulation dans les grandes villes. L'accroissement de la population impose le coût de réaménagement du territoire, induisant par la suite une demande et une consommation à grande échelle. L’exemple type de la pollution des grandes villes est lié à l’urbanisation. Ainsi, dans plusieurs régions du monde, les métropoles mondiales ou mégalopoles affichent un niveau de pollution très élevé comme à Shanghai, New Delhi, Dakar ou Johannesburg. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables de la mauvaise qualité de l’air. Une fréquence élevée de problèmes respiratoires, de maladies cardiaques ou de cancers du poumon peut être observée sur ces populations.
L’agriculture intensive et le rejet des déchets industriels
L’agriculture intensive des années 70-80-90 en est la cause principale de la pollution du sous-sol jusqu’à la nappe phréatique. Avec l’explosion démographique, la production agricole ne suffit plus. Par conséquent, les grands pays industrialisés ont eu recours à l’utilisation d’engrais chimique et de pesticides dans un premier temps. En conséquence, la fertilité du sol s’est appauvrie, tout comme la qualité de l’eau. Vu que l’application des procédures de traitement des déchets industriels impose un budget supplémentaire aux entreprises, d’autres groupes ont toujours préconisé les méthodes traditionnelles d’évacuation des déchets dans les rivières et les océans. Au fil des années, la liste des espèces animales en voie d’extinction s’est étoffée, au désarroi des habitants. En l’absence d’un contrôle assez rigoureux par les autorités publiques, certaines entreprises continuent de polluer à l’insu des habitants. Dans les années 1990-2000, les organismes génétiquement modifiés complexifient cette dégradation de l’environnement. Ces plantes sont les principales causes de l’érosion génétique et de la disparition de plus de 75 % de la diversité génétiques des variétés agricoles dans le monde. En outre, les insectes et les oiseaux pollinisateurs peuvent être infectés à leur tour, et modifier le cycle complexe de la nature.
Les ressources naturelles menacées
Les grandes forêts tropicales d’Afrique, d’Amérique et d’Asie restent les principales ressources en oxygène de la planète. Alors que l’abattage massif des arbres et l’exploitation illicite des bois précieux (ébène, palissandre, teck, bois de rose, etc.) se poursuit dans les pays du tiers-monde, ces derniers n’arrivent plus à absorber le CO2 par la photosynthèse. Le poumon de la planète est fortement menacé, d’autant plus que les matières premières pour la fabrication des médicaments se trouvent dans la nature. La disparition des espèces endémiques et des plantes médicinales augmentent la prolifération de maladies difficiles à traiter, telles que le cancer. La surpêche est une des principales causes de l’épuisement du stock des ressources halieutiques dans le monde. Alors qu’il faut nourrir une population toujours plus grande, les ressources marines côtières commencent à s’épuiser. À cela s’ajoute la disparition de tout un écosystème marin sur plusieurs kilomètres carrés, suite aux marées noires ou au rejet en mer de produits chimiques ou de produits toxiques.
De nombreux enjeux environnementaux
La préoccupation de l’avenir de l’être humain est au centre des débats. De nombreux enjeux environnementaux visent à minimiser ces risques. Aujourd’hui, l’usage intensif des énergies fossiles a atteint ses limites. La pollution des eaux potables devient très coûteuse. La raréfaction des ressources, la désertification, la les catastrophes naturelles se font de plus en plus ressentir.
Un monde contrasté
Pendant que les pays industrialisés financent des produits de grandes marques, les déchets des produits électroniques de masse sont difficiles à maîtriser. L’une des solutions favorisées aujourd’hui consiste à envoyer ces déchets sous forme de dons dans les pays du tiers-monde, se débarrassant ainsi des produits toxiques contenus dans ces appareils. D’un autre côté, les produits électroniques usagés sont retournés pour « recyclage » dans les pays fabricants. Les chiffres sont alarmants, car plus de 60 % des déchets convergent vers les pays de l’Asie du Sud-est notamment la Chine, le Singapour et la Taïwan. Et la règle de gestion du recyclage ne respectant plus les normes. Pour cause, le coût de la main d’œuvre des usines bon marché, qui n’imposent pas de règle stricte de sécurité aux ouvriers. En conséquence, les problèmes d’inhalations des macromolécules nuisent fortement à la santé des travailleurs : plomb, mercure ou cuivre toxiques. Les enfants ne sont pas écartés, car les décharges électroniques jonchent dans les rues. La population vivant à proximité peut être frappée de graves maladies d’infertilité, de problèmes de croissance chez les enfants, de problèmes respiratoires ou encore d’une dégradation du patrimoine génétique.
Extraction minière et dégradation de l’environnement dans le tiers-monde
Mis à part part le pétrole, les terres rares et les métaux précieux contribuent énormément au fonctionnement des appareils électroniques du quotidien : ordinateurs portables, smartphones, tablettes ou télévisions à écran plat. Il se trouve que l’extraction des minerais utiles à la fabrication de ces produits représente une grande menace pour l’environnement et la population locale. L’activité minière modifie le paysage naturel, le dépôt des déchets solides appauvrit le sol et le rejet des liquides menace la qualité de l’eau souterraine. Les entreprises responsables de ces actes peuvent parfois bénéficier d’une réglementation relativement souples, grâce à des rapports d’impacts environnementaux concluants, qui ne reflètent pas nécessairement la réalité au niveau communautaire. Mis à part l’exploitation illicite des ressources naturelles et forestières, la dégradation de l’environnement devient un acte volontaire et l’une des principales causes de la destruction de l’écosystème, de la biodiversité, provoquant le déplacement forcé de la population vers les grandes villes. Si la nature ne suffit plus à nourrir leurs familles, ces derniers doivent s’adapter à la vie dans les grandes villes.
Désertification et catastrophe naturelle
La désertification menace les terres arables des pays du tiers-monde. La terre n’étant plus cultivable, la population commence à migrer dans les villes, et c’est une des principales causes d’immigration dans les pays développés, notamment au Mexique, en Éthiopie, le Sahel, en Asie ou le long de la côte méditerranéenne. La désertification n’est qu’une suite logique de la dégradation du sol, de la mauvaise gestion de l’eau et du changement climatique. Au début des années 2000, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus dévastatrices, notamment avec le tsunami en Asie du Sud-est, Katrina aux États-Unis, les pluies torrentielles en Europe, les feux de brousse des forêts sèches, les tremblements de terre au Japon ou à Haïti. En prenant conscience de la déforestation, de l’érosion des sols, de la pollution atmosphérique,les activités humaines restent les principales causes des catastrophes naturelles. Bien qu’elles soient pour la plupart imprévisibles. L’effet de serre contribue à la diminution de la couche d’ozone, et est responsable de la fonte glaciaire, ce qui va contribuer à la montée du niveau de la mer et la disparition de nombreux atolls et micro îles dans le Pacifique.
De nombreuses mesures de protection de l’environnement
Pour faire face à la dégradation de l’environnement, les dirigeants de pays industrialisés commencent à imposer des mesures environnementales pour améliorer leur quotidien. Ces acteurs peuvent aussi développer des projets environnementaux, jusqu’aux petites collectivités, pour modifier peu à peu les réflexes de consommation de masse. Des programmes conjoints pour le remplacement du pétrole fleurissent partout dans le monde, et sont adoptés par des pays émergents.
Les énergies alternatives au pétrole et au nucléaire
A ce jour, les énergies renouvelables représentent une part perfectible de l’économie mondiale. Ces nouvelles ressources peuvent produire de l’électricité, de la chaleur, ou recycler des déchets pour produire de l’hydrogène. L’énergie solaire en Allemagne ou la géothermie permettent de fournir du chauffage aux foyers américains. Les techniques pour produire des ressources illimitées sont en plein essor. Produisant de l’électricité sans émettre de CO2, elles n’aggravent pas l’effet de serre. Par exemple, l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie (méthane naturel) peut produire de l’électricité de l’ordre de 10 000 mégawatts. La biomasse consiste à fournir de l’énergie à partir des résidus secs de l’agriculture, des déchets organiques (abattoirs, décharges…) ou des produits de scieries (écorces). En brûlant ces ordures dans une chaudière se dégage une vapeur à haute pression qui génère de l’électricité, utilisable pour le chauffage des maisons individuelles. Plus connue, l’énergie solaire peut produire de l’eau chaude ou de l’électricité. Pour utiliser cette manne, il existe trois méthodes. Dans le cas de l’énergie solaire thermique, des capteurs créent un effet de serre, permettant de chauffer l’eau sanitaire, stockée dans un ballon. La deuxième possibilité consiste à la conversion thermodynamique de la chaleur en électricité. Des capteurs de forme parabolique concentrent les rayons sur un tube dans lequel circule un fluide. Surchauffé, celui-ci actionne un convertisseur qui produit de l’électricité. La troisième possibilité, réside dans la conversion photovoltaïque qui produit de l’électricité par la réaction de la lumière sur des matériaux semi-conducteurs en silicium. L’éolien est une autre façon de produire de l’énergie. Il s’agit de l’utilisation de la force du vent pour produire de l’électricité. Le souffle actionne une hélice ; une génératrice convertit ce mouvement rotatif en courant. Ainsi, une ferme éolienne peut couvrir les besoins en électricité d’une collectivité. Après la biomasse, l’hydroélectricité, ou le solaire, la géothermie est une forme d’énergie renouvelable intéressante, par l’utilisation de la chaleur du sous-sol. La croûte terrestre recèle en effet un énorme potentiel de chaleur, que l’on peut convertir en électricité. Pour cela, il faut forer un puits (sa profondeur peut atteindre plusieurs kilomètres), puis pomper l’eau réchauffée dans les entrailles de la Terre. En surface, cette chaleur est distribuée via un échangeur thermique dans un réseau de chauffage urbain.
Consommer moins et diversifier la production
Selon les défenseurs de l’environnement, l’explosion de la demande mondiale d’énergie n’est pas une fatalité. Jusqu’à présent, le marché de l’énergie a obéi à une logique productiviste tiré du modèle des Trente Glorieuses. Un modèle qui risque de conduire à des impasses économiques et écologiques. Mais pour minimiser les risques, il faudrait diminuer notre consommation énergétique. Pour y parvenir, il faudra d’abord améliorer notre efficacité énergétique. Un exemple concret se trouve dans l’industrie automobile. Plusieurs constructeurs concentrent leurs efforts pour produire en masse des véhicules électriques, thermiques ou hybrides. De plus, les modèles actuels sont devenus de moins en moins gourmands, pour des performances supérieures. De tels progrès sont également faits dans le domaine de l’éclairage, de l’électroménager ou du chauffage. Afin de rationaliser notre consommation, il faudra aussi renoncer à la centralisation de la production et de la distribution de l’énergie, pour s’intéresser, enfin, aux besoins réels de chaque installation, et y répondre au moindre coût en fonction des ressources locales. Cela pourrait permettre d’alimenter en courant les relais téléphonique situés en rase campagne, l’énergie solaire étant moins coûteuse qu’une extension du réseau. Les besoins spécifiques d’un groupe d’immeubles ou d’une usine peuvent être satisfaits par une petite centrale au gaz fonctionnant en « cogénération », voire par les énergies renouvelables : éolienne, solaire ou géothermique. La décentralisation des approvisionnements entraînerait de fortes économies (transport, infrastructures…), tout en ajustant mieux l’offre aux besoins réels. En conséquence, les énergies renouvelables pourraient couvrir une large part des besoins mondiaux en électricité pour la prochaine décennie – jusqu’à plus de 50 %.
La gestion des déchets
La gestion des déchets urbains ou nucléaires doit être maximisée pour réduire les risques de dégradation de l’environnement. Conscients du problème, plusieurs pays commencent à entamer un programme de démantèlement de leurs centrales nucléaires avec de nouvelles installations pouvant accueillir les déchets. Au niveau local, la gestion des déchets domestiques est l’affaire de tous. Plusieurs collectivités décentralisées instaurent l’utilisation des véhicules électriques pour collecter les déchets urbains. En outre, plusieurs entreprises créent de nouveaux services de gestion des déchets. Chaque acteur procède selon ses propres méthodes, l’objectif principal restant d’éduquer la population à mieux valoriser les déchets et les recycler de nouveau pour produire de l’énergie. Par exemple, pour lutter contre la pollution maritime, l’une des solutions consiste à filtrer les eaux usées issues du carénage des bateaux. Bien que l’installation s’avère très coûteuse, le même principe est appliqué dans la filtration des eaux usées issues des usines de peintures, de teintureries ou des déchets nucléaires.
Pour la mise en place d’une politique environnementale forte et pérenne
La 22e Conférence des Parties ou COP22 définit des objectifs propres à chaque pays, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et diminuer la température mondiale à moins de deux degrés celsius. Après l’interpellation des scientifiques, les pays signataires devraient réduire leurs émissions de 50 % d’ici 2030. La mise en place d’une politique environnementale doit refléter leurs engagements à réduire l’émission des gaz polluants dans l’atmosphère. Pour la prochaine décennie, la protection de l’environnement doit s’inscrire dans l’Objectif 8.4 de l’ODD. Ce cadre légal de niveau international définit le programme des emplois verts au niveau des entreprises, ou la promotion de la démarche de croissance verte. Au niveau national, chaque pays doit définir à son tour des mesures incitatives de protection de leur environnement. Par exemple, pour préserver les ressources naturelles, les programmes REDD, puis REDD+ sont des mécanismes issus de la COP. Ces mesures incitent les pays détenteurs de ressources forestières à éviter la déforestation et la dégradation des forêts. Le programme REDD+ consiste à faire participer la communauté forestière à s’engager davantage pour préserver son habitat naturel. Des microprojets ont été développés au niveau local tel que l’écotourisme participatif, l’agroforesterie, la gestion de l’eau par les micro-barrages et l’agriculture. Le financement de ces projets dépend du crédit carbone. Un autre principe consiste à faire payer les entreprises les plus pollueurs au niveau des communautés locales.
Conclusion
La déforestation et la dégradation de l’environnement ne sont pas des problématiques récentes. Depuis la prise de conscience du désastre écologique, la nation tout entière doit mettre en œuvre des mesures incitatives pour la réduction des gaz à effet de serre. L’entreprise doit jouer un grand rôle, notamment dans la procédure de traitement des déchets et le respect des normes de gestion environnementale. Au-delà de l’environnement, il sera primordial d’impliquer dans sa feuille de route l’ensemble de son business ecosystem, et d’opérer une réflexion sur le bien-être au travail. Pour que l’économie verte prenne de l’ampleur, chaque document cadre de politique économique doit définir des directives à appliquer, un modèle à suivre voire un cahier des charges. Objectivement vérifiables, il convient de l’assortir d’objectifs à court, moyen et long terme. L’exemple de l’utilisation des véhicules électriques est un modèle clé de la transition écologique. Pour permettre la mise en œuvre de la protection de l’environnement, l’éducation environnementale doit être développée parmi la population. À tel point que la production des biens et services doit répondre aux besoins de la population et de l’environnement, en évitant le gaspillage. Egalement, des produits recyclables pourraient être réinjectés et générer un nouveau profit. Cette année, la mise en place de l’économie circulaire est une activité prioritaire au niveau des dirigeants. Sa mise en place est prometteuse en créant des emplois, des revenus aux entreprises et une nouvelle source de revenus pour les collectivités locales.